Un film de Stuart Baird
"Les Son'a, les Borgs, les Romuliens...
Vous semblez décrocher toutes les missions faciles !"
Un membre de Starfleet s'adressant au commandant Picard
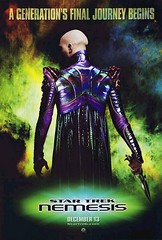 L'aventure cinématographique Star Trek avait de bonnes raisons de s'arrêter au numéro 9, Insurrection, tant les personnages principaux y trouvaient un accomplissement quasi-définitf : Riker et Troi finissent ensemble, même Picard semble avoir trouvé son âme jumelle, et, même si c'est loin d'être le Trek le plus réussi, il est tout à fait honorable, à la hauteur des idées portées par Gene Roddenberry, le créateur de la mythologie. C'était sans compter la Paramount qui, fière de sa franchise, revient à l'assaut par l'intermédiaire du producteur Rick Berman. De plus, l'équipe de Next Generation est tellement liée que tous les participants des films précédents rempilent avec plaisir. Nemesis est-t-il pour autant un film de vacances ?
L'aventure cinématographique Star Trek avait de bonnes raisons de s'arrêter au numéro 9, Insurrection, tant les personnages principaux y trouvaient un accomplissement quasi-définitf : Riker et Troi finissent ensemble, même Picard semble avoir trouvé son âme jumelle, et, même si c'est loin d'être le Trek le plus réussi, il est tout à fait honorable, à la hauteur des idées portées par Gene Roddenberry, le créateur de la mythologie. C'était sans compter la Paramount qui, fière de sa franchise, revient à l'assaut par l'intermédiaire du producteur Rick Berman. De plus, l'équipe de Next Generation est tellement liée que tous les participants des films précédents rempilent avec plaisir. Nemesis est-t-il pour autant un film de vacances ?
Film de détente, c'est en tous cas ce dont a l'air Nemesis à l'ouverture : la scène du mariage sent bon les retrouvailles, et les blagues potaches sont légions mais ratées : ainsi, la gueule de bois de Worf loupe complètement le coche, l'acteur Michael Dorn n'étant pas formidable dans la séquence (Stuart Baird ne voulait pas de cette scène, le producteur Berman a pesé de tout son poids pour la conserver : les deux hommes batailleront gentiment pendant tout le film). Le sérieux reviendra vite, dans une intrigue dominée par la figure du miroir.
L'androïde Data va trouver son double, Proto (B4 en version originale), une version moins évoluée du même modèle, auquel il va transmettre son expérience (ses "data"). Dans un second temps, le commandant Picard est mis nez-à-nez avec le prêteur Shinzon (Tom Hardy à ses débuts), chef des Rémiens et accessoirement clone de Picard (en plus jeune), du temps où certains voulaient court-circuiter la Fédération en y infiltrant un des leurs. Chacun étant le reflet de l'autre, les individus se questionnent sur le sens de leur vie, celle qu'ils ont choisie ou subie. Cette partie du film, fort peu spectaculaire, est véritablement intéressante ; mais elle est coincée au milieu d'une foultitude d'autres enjeux qui parasitent la narration. A l'origine encore plus ambitieux, le film aurait du totaliser 2h40, si l'on en croit les nombreuses scènes coupées présentées en bonus sur le blu-ray. En coupant des bouts de scènes, raccourcissant deci-delà, égalisant ou tranchant, les décideurs ont un peu sabordé Nemesis, qui avait les bases d'un bon Trek.
Rattacher les deux face-à-face Data/B4 et Picard/Shinzon n'était pas la meilleure des idées, tant on capte difficilement le lien entre cette histoire du cheval de Troie galactique (Data/B4) et l'offensive voulue par Shinzon. Ajouter là-dessus la découverte d'une menace chimique contrôlée par Shinzon, et l'image est complète.
Tom Hardy, pour son premier rôle important au cinéma, essaime une ambiguité palpable, similaire à celle qui avait fait les beaux jours de Premier Contact avec la Reine Borg. Si sa ressemblance avec Patrick Stewart n'est pas évidente, il arrive tout de même à faire passer une similarité de regard qui aurait basculé du côté obscur.
Les effets spéciaux, passage obligé d'un bon film de SF, sont omniprésents autant que réussis : jamais l'Enterprise n'aura autant brillée. Stuart Baird, plutôt habitué aux films d'actions et au montage (rien moins que sur Superman, le film, La malédiction, Ladyhawke, ou dernièrement Casino Royale et Skyfall), signe un film passable, réussit les séquences qu'il faut (la première rencontre entre Picard et Shinzon, la collision de l'Enterprise avec la vaisseau des Rémiens) mais passe à côté d'un très bon film : dommage.
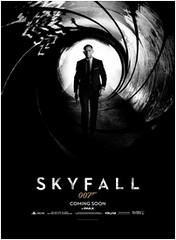 Le James Bond de l'an 2012 est différent. Après la paire Casino Royale /
Le James Bond de l'an 2012 est différent. Après la paire Casino Royale / 
 Galvanisé par la réussite artistique et commerciale de
Galvanisé par la réussite artistique et commerciale de 
